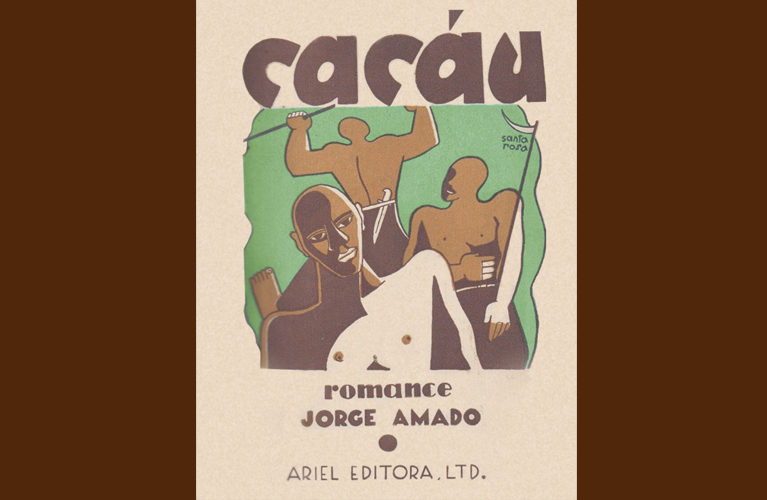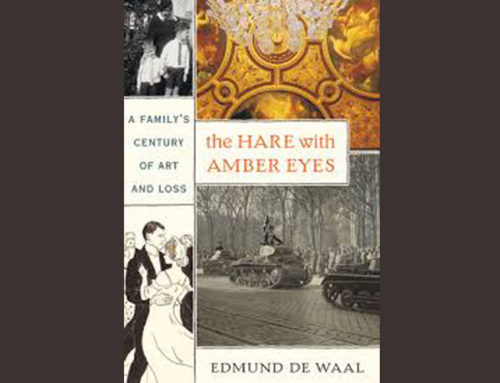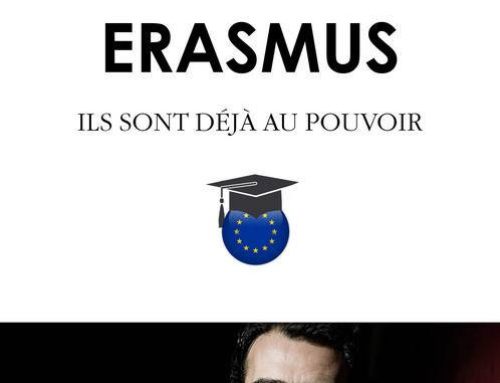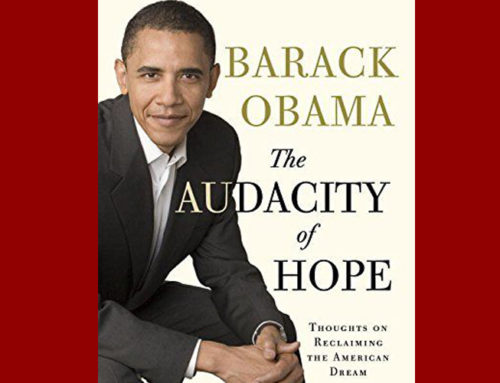tratto da Jorge Amado, “Cacau”
Editore : Grapiúna Produçoes Artísticas Ltda, 1933
tradotto dal Portoghese (Brasile) in Francese da : Jean Orecchioni (per le Editions Stock)
Dans le sud de Bahia, cacao est le seul mot qui sonne bien. Les plantations sont belles lorsqu’elles sont chargées de fruits jaunes. Au début de chaque année, les colonels[1] regardent l’horizon et font leurs prévisions sur le temps et sur la récolte. Alors viennent les « forfaits » avec les ouvriers. Le « forfait », sorte de contrat pour la récolte d’une cacoyère, se fait en général avec les ouvriers qui ont femme et enfants. Ils s’engagent à faire la récolte sur toute une plantation, et peuvent louer des ouvriers pour les aider. D’autres, ceux qui sont seuls, sont à l’embauche particulière. Ils travaillent à la journée et dans tous les emplois, à l’abatture des fruits, à la mise en tas, à l’égouttoir et aux barcasses. C’était la grande minorité. Nous avions trois mille cinq cent reis par jour de travail, mais dans les bonnes époques on était arrivé à payer cinq milreis.
Nous partions le matin avec les longues gaules au bout desquelles une petite faucille brillait au soleil. Et nous pénétrions au milieu des cacoyers pour la cueillette. Sur l’ancienne cacaoyère de João Evangelista, l’une des meilleures de la propriété, travaillait un groupe important. Honorio Nilo, Valentin, moi, et une demi-douzaine d’autres, faisions la cueillette. Magnolia, la vieille Julia, Siméon, Rita, João Grilo et d’autres mettaient en tas et ouvraient les cabosses. Il se formait des tas de ces fèves blanches, d’où s’écoulait le suc. Nous, ceux de la cueillette, nos nous éloignions les uns des autres et à peine échangions-nous quelques mots. Ceux de la mise en tas causaient et riaient. L’équipe du transport de cacao mou arrivait, envahissant la cacaoyère. Le cacao était amené à l’égouttoir pour les trois jours de fermentation. Nous devions danser sur les fèves gluantes, et le suc adhérait à nos pieds. Suc qui résistait aux bains et au savon en pâte. Puis, débarrassé du suc, le cacao séchait au soleil, étendu sur les barcasses. Là encore nous dansions dessous et chantions. Nos pieds étaient étalés, les doigts écartés. Au but de huit jours les fèves de cacao étaient noires et sentaient le chocolat. Antonio Barriguinha, alors, emmenait des sacs et des sacs à Pirangi, en convois de quarante et cinquante bourricots. La plupart des « loués » et des forfaitaires ne connaissaient du chocolat que cette odeur qu’a le cacao.
Lorsque arrivait midi (le soleil servait d’horloge) nous arrêtions le travail et nous nous joignions à l’équipe de la mise en tas pour le repas. Nous mangions le morceau de viande sèche et les haricots noirs cuits depuis le matin, et la bouteille de tafia courait de main en main.
On claquait de la langue et on crachait un bon coup. Nous restions à causer sans faire attention aux serpents qui passaient, en faisant d’étranges bruits dans les feuilles sèches qui tapissaient complètement le sol. Valentin savait des bonnes histoires, et nous les racontait. Agé de plus de soixante-dix ans, il travaillait comme bien peu d’entre nous, et buvait comme personne. Il interprétait la Bible à sa façon, entièrement différente de celle des catholiques et des protestants. Un jour il nous conta le chapitre d’Abel et Caïn :
- Vous savez pas ? Eh ben ! c’est dans les livres…
- Raconte, le vieux
- Dieu avait donné en héritage à Caïn et Abel une plantation de cacao à se partager. Caïn, qui était un mauvais homme, divisa la propriété en trois parts. Et il dit à Abel : « ce premier morceau est à moi ; celui du milieu est à moi et à toi ; le dernier, à moi aussi ». Abel répondit : « Ne fais pas ça, mon petit frère, que ça me fend le cœur… ». Caïn rigola : « Ah ! ça te fend le cœur ? Eh ben, tiens ». Il tira son revolver et – poum – il tua Abel d’un seul coup. Ça se passait il y a longtemps…
- Caïn doit être le grand-père du <Coronel> Mané-la-Peste.
- J’t’en fous. La grand-mère de Mané-la-Peste était putain à Pontal.
- Tu l’sais, Honorio ?
- Sa mère est morte de faim quand elle a plus pu baiser. Le fils était même pas là…
- Le salaud…
- Mais il avait honte pour la mère.
- Sa mère à lui…
Jaque et banane, nos uniques et invariables desserts. Nous n’en connaissions pas d’autre. Quand le déjeuner s’achevait, João Grilo grimpait au jaquier et décrochait les fruits mûrs. Nous mangions avec les mains, les doigts pleins de glu. Les femmes préféraient les jacques dures. Nous, les hommes, plongions les doigts dans les molles. João Grilo, tout maigre comme il était, mangeait comme quatre. Il avait battu le « record » en mangeant un jour cent deux grains. Cela courait les plantations comme une légende. Mais João Grilo se sentait capable de renouveler sa prouesse.
Algemiro passait toujours monté sur « Carbonato », son âne préféré, pour inspecter les ouvriers. Il protestait si le travail allait trop lentement.
- Ça va pas vite… Vous avez tout des limaces.
Honorio répliquait, l’air buté :
- T’as déjà oublié que le boulot est dur ? Quand t’étais ouvrier, ça allait plus vite ?
Algemiro n’aimait pas qu’on lui rappelât cette époque. Il frappe son âne :
- Je veux pas discuter. Y s’agit de travailler…
La cueillette continuait. Les cabosses tombaient avec un bruit sourd : pan-pan.
Honorio chantait des chansons de macumba :
Je suis un Indien
Je m’habille de plumes
Si je suis venu sur terre
C’est pour boire du jurema[2]
Ombre. Ombre épaisse. Le vent, lorsqu’il secouait les arbres, faisait tomber des gouttes d’eau sur nos épaules nues. Nous frissonnions. João Grilo avait fait une fois un calembour, une des grandes fiertés de sa vie de mulâtre vantard :
- Pour ces gouttes, y a qu’la goutte…
Et il renversait la bouteille.
Honorio, tout en cueillant, cherchait son idéal.
Je veux une brune
Qui soit jolie
Qui soit jolie
Avec son ruban.
La brune n’apparaissait pas.
Je veux une veuve
Qui soit riche
Qui soit riche
Et à l’agonie.
Mais ni la brune ni la veuve ne se montraient. Magnolia souriait aux chansons, les yeux perdus au loin, les mains actives malgré tout, ouvrant les cabosses avec le bout de son coutelas. Elle pense a Colodino, imaginons-nous. Et dans nos vies sans amour (l’amour peut-il exister sur les plantations de cacao ?…) nous avions des moments de nostalgie. L’amour serait il fait seulement pour les riches ? Honorio disait à haute voix ce que nous disions en nous mêmes :
- Putain de vie.
Les barcasses longues et larges faisaient pense à un groupe de bêtes aux gueules béantes dormant au soleil. Les fèves séchaient. Nous, deux fois par jour, dansions dessous, une danse dans laquelle les pieds seuls remuaient. Le soleil brûlait les épaules nues. L’égouttoir, au fond, rectangle sale, par les ouvertures duquel s’écoulait un liquide visqueux, ressemblait à une ratière. Et, dominant tout, l’étuve, où le cacao séchait, les jours de pluie, au moyen du feu, avec son grand four. Lorsqu’il pleuvait, nous placions rapidement les couvertures de zinc sur les barcasses. Et en juin et juillet presque tout le cacao allait à l’étuve, car les jours de soleil devenaient rares.
L’étuve nous happait un à un et nous travaillions sous une chaleur infernale. L’enfer, même celui de la description des pères allemands de São Cristóvão, ne pouvait être pire. Nous transpirions comme des damnés, et quand nous sortions de là, les pantalons « porte de boutique » trempés, nous nous précipitions dans la rivière.
Une fois, pourtant, João Amaro, après le travail à l’étuve, suça une pastèque. Nous fîmes la veillée auprès du cadavre pendant toute la nuit. Et nous commençâmes à craindre l’étuve comme un ennemi puissant. João Amaro laissait une femme et trois enfants. La vieille et deux des filles se mirent à faire la vie. La troisième alla habiter avec Siméon sans bénédictions inutiles de juge ni de prêtre.
Nous bavardions un soir, devant l’économat, tout en aiguisant nos couteaux.
Algemiro sauta à bas de son âne :
- Deoclécio.
Le barcassier demanda :
- Qu’est ce qu’il y a ?
- J’ai reçu une lettre du Coronel
- …
- A la dernière expédition, il y a eu trente arrobes de « good ».
- « Good » ? Dans mes barcasses, y a eu que du « supérieur ».
- Alors c’est des barcasses de Zé Luis.
- Ça se peut.
- Le Coronel a dit de renvoyer le barcassier.
- C’est le jour des sacs aujourd’hui. Zé Luis vient ici…
Zé Luis travaillait sur les cacaoyères les plus éloignées de la propriété. Il était responsable des barcasses et il avis commis un crime impardonnable aux yeux des coronels: il avait laissé moisir trente arrobes de cacao. Le cacao « good » se vendait deux milreis moins cher que l’arrobe. Zé Luis buvait beaucoup et souffrait de paludisme chronique. Mais ni le tafia ni la maladie ne l’empêchaient de travailler. L’un et l’autre faisaient parties de sa vie.
Quand il arriva, nous le regardâmes avec une sorte de tristesse. Algemiro l’avertit :
- T’es renvoyé, Zé Luis.
- Pourquoi ?
- Trente arrobes de cacao « good ».
- C’est ma faute, à moi ? C’est manque de chance, s’il a plu. Le Coronel voulait le cacao en vitesse…
- C’est les ordres. João Vermelho !
Le dépensier se montra :
- Qu’est-ce que c’est ?
- T’as fait les comptes de Zé Luis ?
- Ça y est.
- Il lui reste quelques choses ?
- Dix-huit milreis.
Zé Luis se résignait :
- Ça va. Donne les ronds, j’vais aller chercher du boulot ailleurs.
- Non, m’sieu, protesta Algemiro, tu vas payer la perte du Coronel. Deux milreis par arrobe. Y en a trente. Ça fait combien, João Vermelho ?
- Soixante milreis.
- Tu vas travailler à la plantation jusqu’à tant qu’t’aies remboursé.
- De quoi ? Rembourser mon cul, oui…
- C’est comme ça.
- Et avec quoi qu’je bouffe ?
- Bouffe des bananes…
- J’suis pas esclave.
- Démerde-toi.
- J’fous le camp et je veux mon fric.
- On t’paye pas.
La nuit, sans son argent, Zé Luis s’enfuit. Algemiro et João Vermelho partirent sur ses traces, avec des bonnes montures, lui prirent son coutelas et son baluchon, et le bruit courut sur la propriété qu’ils l’avaient passé à tabac. Il courut aussi le bruit que c’est Zé Luis qui tira sur Algemiro, par une nuit sans lune, sur la route de Pirangi.
La mère Margarida vendait du vesou et du tafia verdâtre (il y avait une croix à l’intérieur de la bouteille) au milieu de la route. Une grossière cahute de paille. Les cinq gosses couraient dans la brousse, nus, le visage haché de cicatrices dues aux épines. Je ne sais pourquoi le Coronel tolérait ce petit commerce de la mère Margarida à l’intérieur de la propriété. Usée par les chagrins, elle paraissait cinquante ans ; mais je pense qu’elle avait à peine la trentaine. Son histoire serait qualifiée par les écrivains d’horrible tragédie, si les écrivains venaient sur les plantations de cacao.
Le mari, condamné à dix-huit ans, purgeait sa peine en prison. Histoire toute simple du sud de l’Etat. Ils étaient venus de Ceara, il y avait bien longtemps de cela. Le mari s’était trouvé devenir « fermier » du Coronel Henrique Silva, à Palestina. Intéressante forme de contrat de travail que l’affermage. La propriété charge un chef de famille de défrichage d’un coin de forêt et de l’établissement d’une plantation sur le terrain. Le « fermier » reste maître du terrain pendant le deux ou trois années du contrat. Il plante du manioc et des légumes, avec quoi il vit. Et en fin de contrat le patron paie de cinq cent à huit cent reis le pied de cacaoyer.
Osvaldo, le mari de Sinha Margarida, avait fait une affaire de ce genre avec le Coronel Henrique Silva. A la fin du bail, il voulut aller recevoir son argent. Le Coronel ne paya pas. Lui alla à Ilhéus trois ou quatre fois se plaindre aux autorités. A la fin, le commissaire répondit :
- Ce sont des querelles de bonnes femmes, ces histoires-là. Réglez ça en homme.
Osvaldo repartit et, le soir, il tua le Coronel à coups de couteau. Le procureur fit une belle harangue, citant la Bible et déclamant des vers. L’avocat de la défense (qui n’était pas payé) ne fit aucun effort. Le jury, composé de propriétaires, condamna l’accusé à dix-huit ans, pour faire un exemple. Sa femme et ses enfants vinrent le voir en prison. Il pleura pour la première fois de sa vie. Et maudit le cacao.
Sinha Margarida avait erré au hasard. Elle avait fini au Domaine Fraternité[3], à vendre du vesou. Les gosses aidaient déjà les ouvriers à la mise en tas et gagnaient cinq cent reis par jour. Malgré sa haine du cacao, elle avait peur de retourner au Ceara avec la sécheresse. Ici, du moins, ils mangeaient. Il y avait des jaques en abondance.
La propriété du Coronel Misael, la plus grande de l’Etat, occupait une superficie immense. Notre case et une trentaine d’autres se trouvaient au centre du domaine, mais certaines en étaient distantes d’une lieue ou une lieue et demie. Le jour des « sacs », le samedi, tous les ouvriers se réunissaient devant l’économat, en attendant que João Vermehlo prît son service. Dans la cour de la maison de maître, des poules et des poulets picoraient. Des porcs gras et sales passaient. Il y avait un urubu apprivoisé, « Garcia », qui nous becquetait amicalement les pieds. Nous bavardions, commentant la récolte et le travail. On faisait des projets pour la soirée au village. João Vermehlo arrivait lentement et saluait :
- Notre-Seigneur Jésus-Christ te donne le bonsoir, répondait Valentin.
Nous entrions, le sac sur l’épaule, l’air fatigué, acheter les provisions de la semaine.
- Nilo, appelait João Vermehlo.
- Un kilo de viande, deux livres de haricots, une demi-livre de savon, une demi-livre de sucre, un litre de tafia et un demi-litre de pétrole.
Et nous défilions ainsi un par un ; une fois servis, nous ressortions faire la causette. João Vermelho, derrière le comptoir, pesait les marchandises demandées. Parfois il protestait :
- Pour quoi faire, deux kilos de viande sèche ? Après tu t’plaindras d’avoir plus rien. Tu bouffes de trop…
Il avertissait un autre :
- Tu dois de l’argent. Prends en pas beaucoup.
Les gars mangeait moins cette semaine-là. Et João Vermelho inscrivait sur un énorme livre de comptes les achats des ouvriers. Seul le patron et lui connaissaient les prix. Nous étions obligés d’acheter à l’économat du domaine. Pas étonnant qu’il ne nous restât jamais d’argent.
Dehors, on parlait de la récolte :
- Ça donne, cette année…
- Rien qu’la Mata-Seca fait dix mille arrobes.
- João Evangelista fait trois mille, expliquait Honorio.
- Savez que l’Coronel s’amère par ici ?
- Passer la Saint-Jean, c’est pas ça ?
- Ouais, avec la famille.
- Qui c’est qui va être de repos ?
Le Coronel avait l’habitude de mettre un ouvrier à la disposition de sa famille pour aller chercher les fruits, l’eau, le bois et accompagner sa fille dans ses promenades sur la propriété.
- Une planque !
- C’est pas moi qui en veux. La dona Arlinda est vache comme tout.
- Mais la fille est une belle môme.
- Elle nous regarde même pas.
Honorio avait été mis à leur disposition l’année précédente. Il racontait :
- Elle fait même pas attention au type qui l’accompagne. Y a pas orgueilleuse comme celle-là. Elle te voit même pas. T’en restes tout couillon.
On faisait des projets pour les descentes à Pirangi. Puis nous allions nous baigner à la rivière. Aux premières étoiles ceux qui habitaient loin partaient, emportant le lumignon allumé, l’oreille à l’écoute, dans la crainte de la « vipère-qui-éteint-le-feu ».
Honorio mettait son costume du dimanche et affirmait :
- J’vais faire employé de commerce.
La nuit enveloppait tout. Des guitares pleuraient, des oiseaux pépiaient. Les fruits jaunes des cacaoyers, les serpents qui sifflaient. Les étoiles brillaient au ciel. Les torches sur la route semblaient des âmes en peine courant par le pays. La nuit sur les plantations est triste, obscure, douloureuse. C’est la nuit que les gens pensent…
[1] cfr., nota di Zaman : Coronels, fino ad epoca molto recente, era appellativo usato per designare i ricchi latifondisti brasiliani, signori feudali in grado di imporre ai loro lavoratori agricoli, affittati a stagione per salari miserabili, ogni tipo di corvé. In alcune zone remote del Brasile, dalle piantagioni delle Nord-Est e Pernambuco, fino alle zone coltivate dell’Amazzonia, tali tradizioni ancestrali, e da molti punti di vista primitive, sono talvolta ancora tollerate, tanto che l’Organizzazione Internazionale del Lavoro segnala regolarmente casi di « schiavitù di fatto » in alcune parti di questo gigantesco paese. Questa condizione di sfruttamento degli operai agricoli, unitamente a varie forme di caporalato o mezzadria senza scrupoli, é regolarmente osservata sin dall’antichità anche in tanti altri luoghi del pianeta.
[2] Ndt : bevanda magica
[3] é il nome della piantagione di cacao a sud di Bahia (Brasile) dove Jorge Amado ambienta questa storia